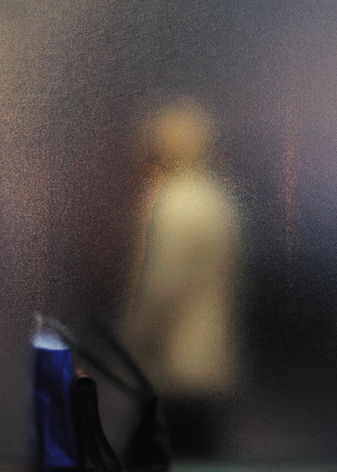Acteur : celui qui joue un rôle. Or, il n’y a pas dans l’oralité obligatoirement quelque chose à jouer, quelque chose à remplir de son corps et de sa voix, quelque chose à rajouter au texte avec le corps et la voix.
Le théâtre et sa proposition de « personnage », demande une incarnation du texte. Le texte de théâtre est écrit dans l’attente d’un corps, parfois même d’un physique particulier. On peut même dire que certains rôles, donc textes, appellent une couleur de voix : rauque, claire, grave etc. Il y a donc bien une écriture spécifique de théâtre qui, si elle dit trop, parle trop, ne laisse plus de place au corps de l’acteur et donc à la mimique, au mouvement, au geste, au rythme, à la respiration, à la voix du comédien. On peut dire du texte de théâtre qu’il est non pas à proprement parler un texte mais plutôt un fragment, un habit posé sur un cintre qui demande à être enfilé pour être entendu et vu. Car, il y a du voir, à voir dans le texte de théâtre. Le texte n’est effectivement complet qu’en se mouvant à travers les corps dans un espace. La lecture d’un texte de théâtre propose ou provoque un imaginaire spatial, corporel et vocal. Et c’est dans la lecture de cette absence du corps que se construit l’imaginaire du lecteur qui va remplir le texte de théâtre et le compléter.
Or, un livre, ce que j’appelle un livre à savoir un roman, un essai, de la poésie etc à la différence du texte de théâtre, je n’arrive pas à parler en fait de livre de théâtre, un livre est déjà un corps en soi, qui n’a besoin que de son écriture, du corps du texte pour être compris dans sa totalité. ( Toutefois, en parlant ainsi, je ne tiens pas compte de la lecture individuelle et généralement silencieuse du lecteur anonyme qui est bien quand même déjà un corps dans lequel résonne l’espace et la voix de l’écriture).
Il y a donc des livres qui ne semblent pas et/ou n’ont pas besoin du corps de l’acteur pour être « ENTENDU », « SAISI ». La résonance du corps du lecteur anonyme suffit. Pour d’autres, par contre, il semblerait que l’oralité soit comme un haut parleur et apporte quelque chose que le texte seul ne suffit pas à transporter ou transporte de façon plus élitiste c’est-à-dire demande des lecteurs plus avertis.
Et l’acteur en se faisant passeur de mot devient dans cet instant le vecteur par lequel l’écriture s’ouvre au grand public. Il n’incarne pas un personnage, il est la caisse de résonance, l’instrument par lequel s’incarne la langue. (C’est bien la demande d’un metteur en scène comme Claude Régy à ses acteurs : incarner la langue, on peut même dire l’effort de la langue et non le personnage, ce qui est une façon de renouveler l’idée même de la fonction de la langue théâtrale et donc du dire de la langue au théâtre)
Il semblerait effectivement qu’un texte oralisé en fait sonorisé et porté par l’image d’un corps prenne à ce moment-là place dans la société. L’acteur refait de la lecture un acte public et collectif. Dire un texte, n’importe quel texte, était avant la venue du livre, il ne faut pas l’oublier, sa première publication. Les textes passaient par l’oreille : on récitait, on haranguait, on lisait à haute voix, on chantait, on accompagnait un texte du tambour ou d’instruments ; L’oreille et la vue étaient immédiatement sollicitées et le sens du texte était porté non seulement par la sonorité vocale et instrumentale mais aussi par les gestes, l’habit de celui qui le prononçait, l’espace dans lequel il était prononcé et le moment où il était prononcé: Le sens du texte était donc incarné (le troubadour, le curé, l’annonceur public, l’orateur ). Et l’on écoutait à plusieurs, ensemble, ce qui engendrait immédiatement un questionnement sur le sens politique, moral, magique du texte. La langue oralisée créait de la langue, du sens, de la signification, une nouvelle langue. Elle s’intégrait dans la langue commune.
Si on regarde la poésie mise en chanson ou en chant, ou le récit accompagné musicalement, on s’aperçoit que souvent on ne sait plus qui a écrit le texte, mais son "oralisation" l’a transporté et sauvegardé. On ne peut rien faire d’une écriture dont on a perdu les codes de lecture, alors qu’une sonorité (une musique) traverse les siècles, portée de voix en voix, voix instrumentales ou voix vocales.
L’oralité du texte a toujours fait partie de la société socialement, politiquement, religieusement et artistiquement. La lecture anonyme est née du développement du livre et de l’apprentissage de plus en plus répandu et indispensable de la lecture.
On peut donc dire que la lecture publique était un des rituels de la société et y intervenait à différents niveaux. La lecture publique était à la fois communication d’informations et partage d’une idée ou d’une forme. Tous les textes pouvaient être dit, si tant est qu’il ne faille pas dire que pour être « entendu », tout texte devait être oralisé. Intrinsèquement donc, la langue retourne à la langue. Ou, ne serait-il pas plus juste de dire l’oreille retourne à l’oreille.
Car par quoi caractérise-t-on l’écriture d’un écrivain ? En général par : son souffle, sa sonorité, son rythme, sa manière de poser le mot dans la phrase, dans l’espace de la page, sa respiration. Donc, ce que l’on perçoit d’une écriture, ce qui la porte, la construit, ce qui ouvre son sens c’est bien tout ce qui est autour du mot et non le squelette du mot, mais sa matière, tout ce qui a à faire avec le corps de l’écrivain, son oreille à savoir la manière dont il a entendu, été pénétré par le monde. La langue est maternelle. C’est la sonorité de la langue de notre mère que nous entendons en premier. Il n’y a donc rien de plus inconscient ni intime que la langue. La langue est aussi plus banalement un muscle, muscle qui travaille lors de l’effort de prononciation. La langue est donc avant toute chose prononcée donc le sens est toujours entaché d’une prononciation, d’une sonorité, d’une manière de dire.
Donc effectivement, quand le travail de l’acteur, j’entends par travail son corps et sa voix, se situe non pas dans le vouloir faire passer le sens, en le gonflant par la mise en place d’un ton, c’est-à-dire en faisant de la redondance. Quand un acteur se préoccupe dans son travail de tout ce qui n’est pas le sens du mot mais de ce qui crée le mot, de ce qui l’a fait advenir dans la page, alors l’acteur devient passeur, parce que depuis son corps à lui, depuis son effort à lui, depuis les traces qu’ont imprimées les sons des mots en lui, il peut rendre compte du corps d’où est née l’écriture, à savoir une partie de l’histoire du corps de l’écrivain. Et se faisant, il ne dit pas un texte, il l’incarne et l’incarnant, l’ouvre physiquement. Et dans cet effort physique et mental de prononcer le texte, il touche de sa voix et par la vision qu’il donne de son propre corps le corps des autres. Il est alors créateur d’une sensation physique qui devient (redevient) porteuse de sens et d’imaginaire.
La venue du livre a développé par contre un autre type d’écrit, celui où le mot n’est pas dissociable de l’espace de la page dans lequel il est posé. Le mot devient signe dans la page. Il fait sens à l’intérieur de la page. Sa sonorité, sa matière sont à ce moment-là inscrites dans l’espace de la page, à l’endroit où est posé le mot. Il devient dessin, signe pictural, tableau, vision inséparable de l’intimité de la feuille. On peut dire que dans ce type d’écriture, le travail de l’acteur se fera sur un manque, celui de la vision de l’écriture de la page, qui donne à voir et à entendre directement.
Finalement, l’écriture n’a jamais perdu son origine : c’est la voix qui porte l’écrit qui a porté l’écrit généralement avant même que l’écrit s’écrive. Là se situe l’acteur, dans ce passage entre le texte muet dans le livre et celui qu’il réchauffe dans son corps et ses mains comme dans la parabole des paroles gelées de Rabelais. Des textes, et ç’aurait été à explorer, déclenchent chez l’acteur désir de dire, lequel va provoquer à son tour chez le lecteur mouvement vers le texte, désir de lire. Et ce travail de passage se situe au confluent et à la rencontre de deux arts, celui de l’écrivain d’un côté, celui de l’acteur de l’autre, le second se mettant au service du premier mais le premier donnant au second la matière même de son art.
Frédérique WOLF-MICHAUX
(Conférence « L’acteur comme passeur du livre» dans le cadre du Carrefour des Ecritures. 2004)
Le théâtre et sa proposition de « personnage », demande une incarnation du texte. Le texte de théâtre est écrit dans l’attente d’un corps, parfois même d’un physique particulier. On peut même dire que certains rôles, donc textes, appellent une couleur de voix : rauque, claire, grave etc. Il y a donc bien une écriture spécifique de théâtre qui, si elle dit trop, parle trop, ne laisse plus de place au corps de l’acteur et donc à la mimique, au mouvement, au geste, au rythme, à la respiration, à la voix du comédien. On peut dire du texte de théâtre qu’il est non pas à proprement parler un texte mais plutôt un fragment, un habit posé sur un cintre qui demande à être enfilé pour être entendu et vu. Car, il y a du voir, à voir dans le texte de théâtre. Le texte n’est effectivement complet qu’en se mouvant à travers les corps dans un espace. La lecture d’un texte de théâtre propose ou provoque un imaginaire spatial, corporel et vocal. Et c’est dans la lecture de cette absence du corps que se construit l’imaginaire du lecteur qui va remplir le texte de théâtre et le compléter.
Or, un livre, ce que j’appelle un livre à savoir un roman, un essai, de la poésie etc à la différence du texte de théâtre, je n’arrive pas à parler en fait de livre de théâtre, un livre est déjà un corps en soi, qui n’a besoin que de son écriture, du corps du texte pour être compris dans sa totalité. ( Toutefois, en parlant ainsi, je ne tiens pas compte de la lecture individuelle et généralement silencieuse du lecteur anonyme qui est bien quand même déjà un corps dans lequel résonne l’espace et la voix de l’écriture).
Il y a donc des livres qui ne semblent pas et/ou n’ont pas besoin du corps de l’acteur pour être « ENTENDU », « SAISI ». La résonance du corps du lecteur anonyme suffit. Pour d’autres, par contre, il semblerait que l’oralité soit comme un haut parleur et apporte quelque chose que le texte seul ne suffit pas à transporter ou transporte de façon plus élitiste c’est-à-dire demande des lecteurs plus avertis.
Et l’acteur en se faisant passeur de mot devient dans cet instant le vecteur par lequel l’écriture s’ouvre au grand public. Il n’incarne pas un personnage, il est la caisse de résonance, l’instrument par lequel s’incarne la langue. (C’est bien la demande d’un metteur en scène comme Claude Régy à ses acteurs : incarner la langue, on peut même dire l’effort de la langue et non le personnage, ce qui est une façon de renouveler l’idée même de la fonction de la langue théâtrale et donc du dire de la langue au théâtre)
Il semblerait effectivement qu’un texte oralisé en fait sonorisé et porté par l’image d’un corps prenne à ce moment-là place dans la société. L’acteur refait de la lecture un acte public et collectif. Dire un texte, n’importe quel texte, était avant la venue du livre, il ne faut pas l’oublier, sa première publication. Les textes passaient par l’oreille : on récitait, on haranguait, on lisait à haute voix, on chantait, on accompagnait un texte du tambour ou d’instruments ; L’oreille et la vue étaient immédiatement sollicitées et le sens du texte était porté non seulement par la sonorité vocale et instrumentale mais aussi par les gestes, l’habit de celui qui le prononçait, l’espace dans lequel il était prononcé et le moment où il était prononcé: Le sens du texte était donc incarné (le troubadour, le curé, l’annonceur public, l’orateur ). Et l’on écoutait à plusieurs, ensemble, ce qui engendrait immédiatement un questionnement sur le sens politique, moral, magique du texte. La langue oralisée créait de la langue, du sens, de la signification, une nouvelle langue. Elle s’intégrait dans la langue commune.
Si on regarde la poésie mise en chanson ou en chant, ou le récit accompagné musicalement, on s’aperçoit que souvent on ne sait plus qui a écrit le texte, mais son "oralisation" l’a transporté et sauvegardé. On ne peut rien faire d’une écriture dont on a perdu les codes de lecture, alors qu’une sonorité (une musique) traverse les siècles, portée de voix en voix, voix instrumentales ou voix vocales.
L’oralité du texte a toujours fait partie de la société socialement, politiquement, religieusement et artistiquement. La lecture anonyme est née du développement du livre et de l’apprentissage de plus en plus répandu et indispensable de la lecture.
On peut donc dire que la lecture publique était un des rituels de la société et y intervenait à différents niveaux. La lecture publique était à la fois communication d’informations et partage d’une idée ou d’une forme. Tous les textes pouvaient être dit, si tant est qu’il ne faille pas dire que pour être « entendu », tout texte devait être oralisé. Intrinsèquement donc, la langue retourne à la langue. Ou, ne serait-il pas plus juste de dire l’oreille retourne à l’oreille.
Car par quoi caractérise-t-on l’écriture d’un écrivain ? En général par : son souffle, sa sonorité, son rythme, sa manière de poser le mot dans la phrase, dans l’espace de la page, sa respiration. Donc, ce que l’on perçoit d’une écriture, ce qui la porte, la construit, ce qui ouvre son sens c’est bien tout ce qui est autour du mot et non le squelette du mot, mais sa matière, tout ce qui a à faire avec le corps de l’écrivain, son oreille à savoir la manière dont il a entendu, été pénétré par le monde. La langue est maternelle. C’est la sonorité de la langue de notre mère que nous entendons en premier. Il n’y a donc rien de plus inconscient ni intime que la langue. La langue est aussi plus banalement un muscle, muscle qui travaille lors de l’effort de prononciation. La langue est donc avant toute chose prononcée donc le sens est toujours entaché d’une prononciation, d’une sonorité, d’une manière de dire.
Donc effectivement, quand le travail de l’acteur, j’entends par travail son corps et sa voix, se situe non pas dans le vouloir faire passer le sens, en le gonflant par la mise en place d’un ton, c’est-à-dire en faisant de la redondance. Quand un acteur se préoccupe dans son travail de tout ce qui n’est pas le sens du mot mais de ce qui crée le mot, de ce qui l’a fait advenir dans la page, alors l’acteur devient passeur, parce que depuis son corps à lui, depuis son effort à lui, depuis les traces qu’ont imprimées les sons des mots en lui, il peut rendre compte du corps d’où est née l’écriture, à savoir une partie de l’histoire du corps de l’écrivain. Et se faisant, il ne dit pas un texte, il l’incarne et l’incarnant, l’ouvre physiquement. Et dans cet effort physique et mental de prononcer le texte, il touche de sa voix et par la vision qu’il donne de son propre corps le corps des autres. Il est alors créateur d’une sensation physique qui devient (redevient) porteuse de sens et d’imaginaire.
La venue du livre a développé par contre un autre type d’écrit, celui où le mot n’est pas dissociable de l’espace de la page dans lequel il est posé. Le mot devient signe dans la page. Il fait sens à l’intérieur de la page. Sa sonorité, sa matière sont à ce moment-là inscrites dans l’espace de la page, à l’endroit où est posé le mot. Il devient dessin, signe pictural, tableau, vision inséparable de l’intimité de la feuille. On peut dire que dans ce type d’écriture, le travail de l’acteur se fera sur un manque, celui de la vision de l’écriture de la page, qui donne à voir et à entendre directement.
Finalement, l’écriture n’a jamais perdu son origine : c’est la voix qui porte l’écrit qui a porté l’écrit généralement avant même que l’écrit s’écrive. Là se situe l’acteur, dans ce passage entre le texte muet dans le livre et celui qu’il réchauffe dans son corps et ses mains comme dans la parabole des paroles gelées de Rabelais. Des textes, et ç’aurait été à explorer, déclenchent chez l’acteur désir de dire, lequel va provoquer à son tour chez le lecteur mouvement vers le texte, désir de lire. Et ce travail de passage se situe au confluent et à la rencontre de deux arts, celui de l’écrivain d’un côté, celui de l’acteur de l’autre, le second se mettant au service du premier mais le premier donnant au second la matière même de son art.
Frédérique WOLF-MICHAUX
(Conférence « L’acteur comme passeur du livre» dans le cadre du Carrefour des Ecritures. 2004)
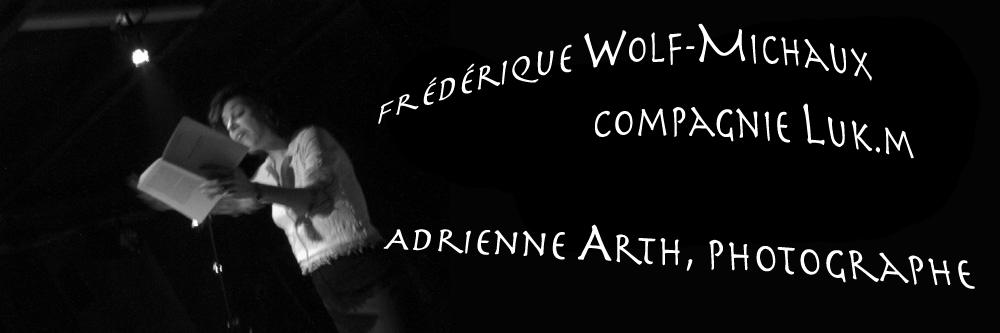
 Conférence de Frédérique Wolf-Michaux: CORPS DU TEXTE CORPS DE L’ACTEUR
Conférence de Frédérique Wolf-Michaux: CORPS DU TEXTE CORPS DE L’ACTEUR
 ACTUALITÉS F. WOLF-MICHAUX
ACTUALITÉS F. WOLF-MICHAUX